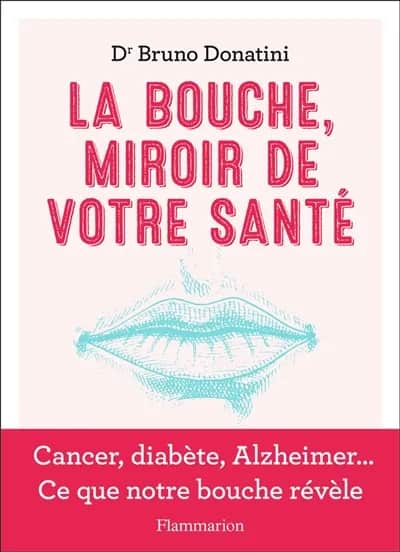
Dr Bruno Donatini
Flammarion, 2022N1
J’ai étudié cet ouvrage avec beaucoup d’intérêt afin de cerner le cadre théorique d’un traitement par mycothérapie (mycélium de champignons alimentaires), sur cette base, qui m’a été prescrit à l’automne 2022.
Il faut le reconnaître, la lecture en est difficile — voire anxiogène — car le sujet est complexe, loin du discours simplificateur et réconfortant des « magazines de santé »… Médecin et chercheur (voir Google Scholar), l’auteur parle beaucoup des maladies auxquelles il est confronté, mais dont l’énumération peut paraître inquiétante à toute personne qui n’a pas une approche positive de son maintien en forme.
Au-delà des idées qui circulent au sujet des microbiotes (bactéries, champignons, virus, phages…) bien souvent réduites au slogan « l’intestin, notre deuxième cerveau », l’auteur attire notre attention sur la bouche comme un « écosystème complexe » dont le microbiote est « la première barrière aux virus, bactéries et autres indésirables venus du monde extérieur ». C’est la deuxième flore la plus abondante de notre organisme, avec dix fois plus de bactéries protectrices que le microbiote intestinal.
Dans cet écosystème interviennent aussi la salive, la langue, les muqueuses, les muscles masticateurs, les dents et les os des mâchoires… L’ouvrage est donc, pour l’essentiel, un plaidoyer pour une attention particulière à l’hygiène buccale, avec des avertissements a contrario de croyances populaires, par exemple la consommation d’huiles essentielles et autres produits antiseptiques (comme l’argent colloïdal) qui détruisent indistinctement les flores bactériennes.
De nombreux détails, parfois difficiles à saisir en raison du vocabulaire spécialisé, sont donnés sur l’action, bénéfique ou délétère, des microbiotes de la bouche, de l’estomac et autres organes du système digestif.
L’auteur décrit (très sommairement) sa méthode pour le diagnostic de dysbioses (colonisation par des organismes « inamicaux ») par l’analyse des gaz respiratoires et l’examen par luminescence (lampe de Wood) de la bouche. C’est ce diagnostic qui lui permet de proposer leur traitement par des champignons alimentaires (mycothérapie), nécessairement associé à une réforme de la nutrition et d’autres pratiques bénéfiques : exercice, etc.
Après ces explications sur la nature et le traitement des dysbioses, on aimerait disposer de références aux études cliniques confirmant la validité du diagnostic via les gaz respiratoires, et l’efficacité de la mycothérapie.
Pour les gaz respiratoires (H2 et CH4), un protocole standard a été proposé à l’échelle européenne (Hammer, HF et al., 2021N2). Des études anciennes proposent la mesure du dihydrogène expiré (H2) pour évaluer la capacité d’absorption des glucides dans l’intestin grêle (Feibusch JM & PR Holt, 1982N3). Chu K Yao and Caroline J Tuck (2017N4) écrivent au sujet du test de l’hydrogène :
Les preuves de la faible reproductibilité intra-individuelle des réponses respiratoires lors de tests répétés pour le fructose et le lactulose sont de plus en plus nombreuses. Compte tenu de ces limites, il n’est pas surprenant que le diagnostic de surcroissance bactérienne de l’intestin grêle basé sur un test respiratoire au lactulose donne un taux de prévalence élevé et ne soit pas fiable. Enfin, il s’est avéré que l’induction de symptômes au cours d’un test respiratoire n’est pas en corrélation avec la présence d’une malabsorption des hydrates de carbone. Les données disponibles suggèrent que les tests respiratoires à l’hydrogène ont une valeur clinique limitée pour guider la décision clinique chez les patients souffrant de troubles fonctionnels de l’intestin.
Un article un peu ancien de Lucy Mailing (2019N5), mais dont elle a confirmé les résultats en 2025 (voir discussion), cite de nombreux travaux démontrant le manque de fiabilité des tests de gaz respiratoires, entre autres pour le diagnostic du SIBON6 :
L’analyse de l’haleine n’est pas fiable pour diagnostiquer le SIBO. Les tests respiratoires ne permettent pas de prédire correctement la charge bactérienne dans l’intestin grêle mesurée par une culture quantitative ou des méthodes basées sur la PCR, et les résultats sont influencés par le temps de transit intestinal, la consommation de glucides et l’apport alimentaire habituel.
Le test respiratoire pourrait être utile pour détecter d’autres pathologies de l’intestin grêle, mais nous n’en savons pas assez pour pouvoir interpréter correctement les résultats. L’analyse de l’haleine peut également guider le traitement, mais il n’existe pas d’essais cliniques de grande envergure.
Pour en revenir à l’ouvrage de Donatini, je reste dubitatif au vu de la rareté de la documentation scientifique : dans les six pages de références bibliographiques, aucune publication — sauf deux de Donatini — n’aborde ces sujets. On peut néanmoins consulter d’autres articles accessibles par Google Scholar : sur les technologies ambulatoires préconisées pour le diagnostic de la pullulation bactérienne du grêle (Donatini B, 2015N7), sur le traitement par mycothérapie du papillomavirus humain (HPVN8) (Donatini B, 2014N9) ou celui de la maladie de CrohnN10 (Donatini B, 2019N11).
Au niveau du travail éditorial, il est regrettable — mais c’est le cas de la plupart des ouvrages francophones — que les DOI facilitant l’accès aux articles ne figurent pas dans la bibliographie. De plus, pour un exposé d’une telle densité, il aurait été souhaitable de disposer d’un index, d’un glossaire, ainsi que d’appels (numérotés) à la bibliographie dans le corps du texte. Ce sont des suggestions pour une prochaine édition…
Enfin, l’auteur fait parfois référence à des études observationnelles dont les résultats (de simples corrélations) sont contredits par des études prospectives randomisées. Celles-ci ne font que renforcer des croyances populaires, par exemple « la consommation de produits bio diminue le risque de cancer » (page 157) appuyée par une publication de piètre qualité (Baudry J et al., 2018N12). L’épidémiologie nutritionnelle ne devrait pas prétendre à la détection de liens de causalité entre alimentation et santé. Voir à ce sujet l’article Consommation d’aliments bio et risque de cancer.
Cela dit, je privilégie le « bio », mais pour de toutes autres raisons ! Cet exemple illustre seulement la citation d’articles sans examen critique, avec un biais de confirmation de convictions personnelles.
Je crains qu’il ne faille encore patienter longtemps avant de disposer d’un ouvrage en français abordant ce sujet sur une base scientifique. Publications à l’appui, répondre aux questions suivantes :
- Toute maladie métabolique est-elle associée à une (des) dysbiose(s) ? Le lien causal est-il prouvé, et dans quel sens ?
- Quelle est la fiabilité des mesures de gaz respiratoires ? Par exemple, variations à 24 heures d’intervalle…
- La mesure des gaz caractérise-t-elle à coup sûr chacune des flores microbiennes, indépendamment d’autres paramètres ? Quelles sont les marges d’incertitudes ?
Quand un thérapeute annonce une « précision » de 0.01 ppm (un centième de parties par millions), à supposer que la mesure soit celle d’un appareil, elle se situerait dans la « zone de bruit »… C’est donc de la pseudoscience. - Les prescriptions de mycéliums sont-elles variables d’un praticien à un autre ? Quelle est leur efficacité ? Comment les doser ?
- Les praticiens paraissent précis et affirmatifs dans leurs diagnostics. Leurs traitements ont-ils démontré leur efficacité ?
À ce jour, je n’ai trouvé aucune réponse à ces questions sur les bases de données bibliographiques de médecine et de biologie humaine. Aucune trace non plus dans les 28 numéros de la Revue des Microbiotes que j’ai reçus à ce jour.
Un auteur qui se répand en affirmations sans en préciser les sources fait acte de négligence ou d’incompétence en matière de publication. Mais on est aussi en droit de supposer que ses « sources » n’existent pas… ?
La science en est à ses débuts dans la connaissance des microbiotes et des processus physiologiques ou pathologiques auxquels ils sont associés. Ce qui laisse de nombreuses questions ouvertes aux équipes de recherche. Mais, dans cet espace d’incertitude, les pseudosciences peuvent glisser des affirmations péremptoires comme par exemple : « 90 % des maladies métaboliques dégénératives chroniques sont corrélées à un microbiote perturbé » suivi de « Maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, et nombre de cancers sont dus à une immunité perturbée par un microbiote altéré et agressif. » Exemple flagrant d’une confusion (intentionnelle ?) entre corrélation et causalité…
Pour en revenir à l’ouvrage, il était difficile de décrire en si peu de pages cette médecine « intégrative ou fonctionnelle », selon les termes de Bruno Donatini, incompatible avec la segmentation anatomique des pratiques médicales conventionnelles. « Tous les organes sont interconnectés » résume bien cette approche.

Lectures complémentaires
- Du gaz dans les neurones – Taty Lauwers (2017N13)
- Sortir de la cacophonie gastrique – Taty Lauwers (2017N14)
- Exercice et santé intestinale – Lucy Mailing
- Que faire face à la constipation ? – Chris Masterjohn
▷ Liens

- Les identifiants de liens permettent d’atteindre facilement les pages web auxquelles ils font référence.
- Pour visiter « 0bim », entrer dans un navigateur l’adresse « https://leti.lt/0bim ».
- On peut aussi consulter le serveur de liens https://leti.lt/liens et la liste des pages cibles https://leti.lt/liste.
- N1 · umd4 · Ouvrage “La bouche, miroir de votre santé” – Bruno Donatini
- N2 · ru6w · Hammer, HF et al. (2021). European guideline on indications, performance, and clinical impact of hydrogen and methane breath tests in adult and pediatric patients : European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, European Society of Neurogastroenterology and Motility, and European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition. UEG Journal 10, 1 : 15–40.
- N3 · b1cg · Feibusch, JM & PR Holt (1982). Impaired absorptive capacity for carbohydrate in the aging human. Digestive Diseases and Sciences 27 : 1095–1100.
- N4 · q17l · Yao, CK & CJ Tuck (2017). The clinical value of breath hydrogen testing. Journal of Gastroenterology and Hepatology 32, S1 : 20–22.
- N5 · d89o · Mailing, L (2019). What the latest research reveals about SIBO. Site personnel de Lucy Mailing.
- N6 · eda2 · Colonisation bactérienne chronique de l’intestin grêle – SIBO – Wikipedia
- N7 · a248 · Donatini, B (2015). Pullulation bactérienne du grêle. Intérêt des nouvelles technologies ambulatoires : test respiratoire couplé à l’élastométrie hépatique, à la recherche des herpès virus dans la salive ou de l’échographie gastro-intestinale. Hegel 2, 2 : 92–99.
- N8 · m44t · Papillomavirus humain – Wikipedia
- N9 · xb2y · Donatini, B (2014). Control of Oral Human Papillomavirus (HPV) by Medicinal Mushrooms, Trametes versicolor and Ganoderma lucidum : A Preliminary Clinical Trial. International Journal of Medicinal Mushrooms 16, 5 : 497–498.
- N10 · ajb0 · Maladie de Crohn – Wikipedia
- N11 · pg34 · Donatini, B (2019). Medicinal Sulphur Polypore Mushroom Laetiporus sulphureus (Agaricomycetes) Plus Tiny Amounts of Essential Oils Decrease the Activity of Crohn Disease. International Journal of Medicinal Mushrooms 21, 3 : 267–273.
- N12 · ir6u · Baudry, J et al. (2018). Association of Frequency of Organic Food Consumption With Cancer Risk : Findings From the NutriNet-Santé Prospective Cohort Study. JAMA Intern Med. 178, 12 : 1597–1606.
- N13 · o10s · Ouvrage “Du gaz dans les neurones” – Taty Lauwers
- N14 · x14h · Ouvrage “Sortir de la cacophonie gastrique” – Taty Lauwers
Article créé le 9/02/2023 - modifié le 2/01/2025 à 07h43

4 thoughts on “La bouche, miroir de votre santé”
Bonjour, dans une certaine mesure, on pourrait avancer que les aliments bio “diminuent les risques de cancer” puisqu’ils sont (théoriquement) dépourvus de résidus de produits “phytosanitaires” cancérogènes.
Oui, “en principe”… Sauf que la corrélation n’a pas été démontrée, voir l’article https://lebonheurestpossible.org/consommation-daliments-bio-et-risque-de-cancer/
Il est regrettable qu’une partie du public, dont je croise certainement des représentants à la boutique bio chaque semaine, croie que le seul risque auquel ils sont exposés est de nature environnementale, ce qui ne les incite pas à améliorer leur style de vie mis à part d’éviter les aliments “non-bio”… Là, bien sûr, je parle de personnes qui ont le temps et les moyens de mettre en place de meilleures habitudes de vie.
La corrélation, les agriculteurs exposés (cette fois massivement) à ces produits délétères qui contractent cette maladie, peuvent la faire. Ceci dit vous avez raison, les causes de cancer sont multifactorielles, c’est une longue “addition” et retirer de celle-ci les produits alimentaires non bio ne suffit pas (mon père est mort d’un cancer malgré le fait qu’il mangeait bio depuis les années 70). Mais la malbouffe a encore de beaux jours devant elle et une bonne hygiène nutritionnelle n’est pas sans impact sur notre santé.
De nombreux clients du “bio” croient — c’était mon cas il y a 50 ans — aux vertus d’une “diète céréalienne” privilégiant les “graines” (céréales, légumineuses, oléagineux) au détriment des “produits animaux”, surtout la maudite viande… Le résultat est que ces personnes sont les plus exposées aux mycotoxines (voir https://leti.lt/t2o1), aux lectines, phytates, etc., que contiennent ces aliments. Ce qui peut avoir un effet désastreux sur leurs flores bactériennes (buccale, gastrique, intestinales) et par voie de conséquence, sur leur système immunitaire, provoquant de l’inflammation chronique à faible bruit. Autant de risques de cancer peut-être plus élevés que celui de la consommation de “malbouffe” des supermarchés !
Cela n’empêche que je consomme fruits et légumes bio, de préférence en local, ne serait-ce que par goût ! Il me semble que les meilleurs arguments en faveur du bio sont la défense de l’environnement (entre autres, des insectes) et la santé des agriculteurs.